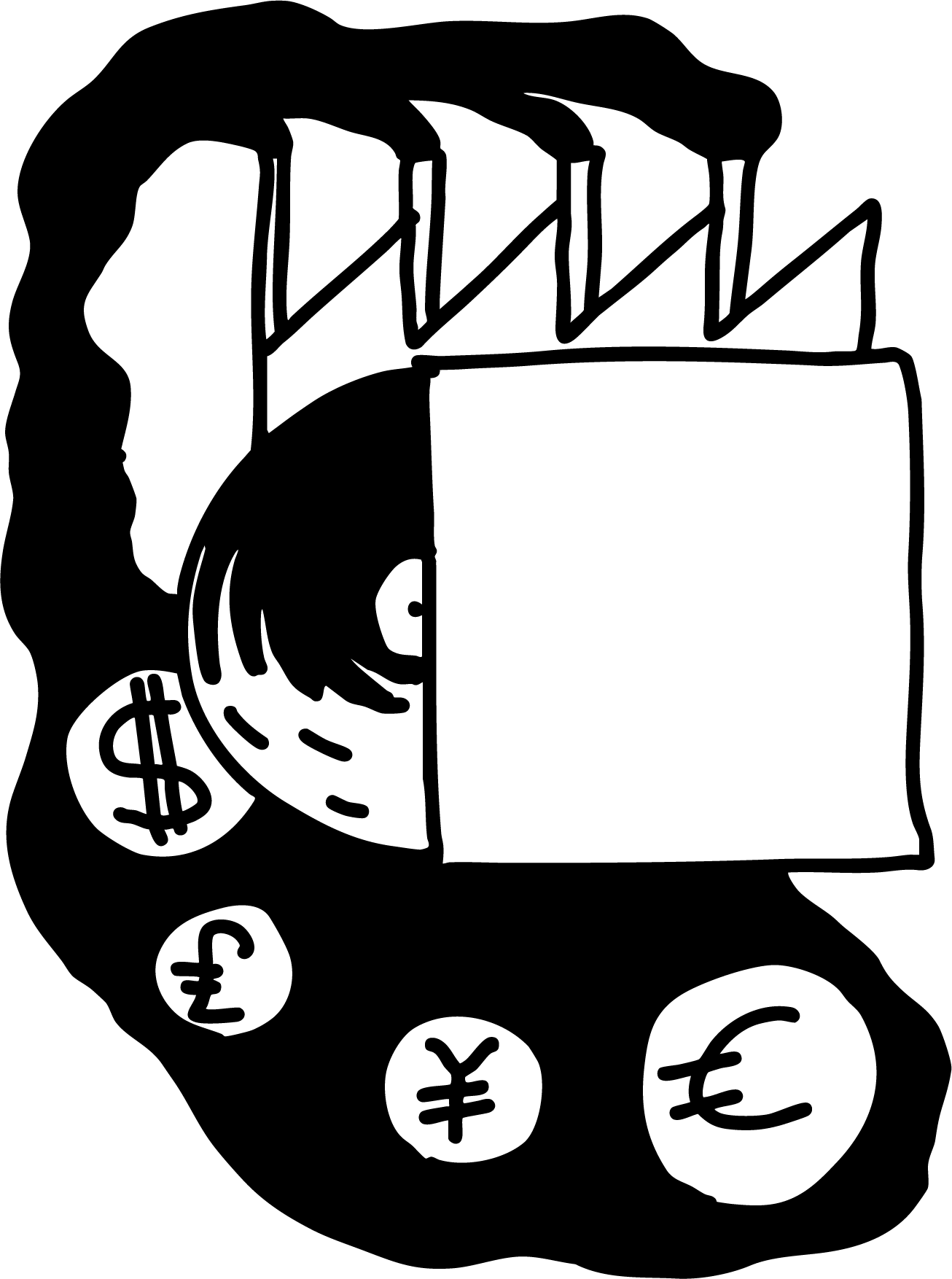La saucisse du pestacle
Illustration de l’industrie culturelle. Artus Rolland, 2025.
Au cœur du malaise occidental, le consumérisme
Le 30 juillet 1954, à Memphis, un jeune chanteur encore inconnu du grand public, Elvis Presley, monte pour la première fois sur scène. Son mélange explosif de gospel, de blues et de country déclenche une hystérie sans précédent dans le public. Ce moment paraît anodin sur le coup, mais il marque une véritable bascule culturelle. Pour la première fois, un artiste devient le catalyseur d’émotions collectives qui se transforment immédiatement en phénomène social. La musique n’est plus seulement un art à contempler dans l’intimité, elle devient spectacle et expérience partagée, annonçant l’ère de la consommation culturelle de masse. La démocratisation de la guitare électrique et le développement rapide de l’industrie du disque matérialisent cette mutation. Derrière Presley, c’est tout un système industriel qui s’organise, transformant la passion et l’émotion en produits commercialisables. La musique, jusque-là liée à une tradition orale ou artisanale, devient un objet standardisé, reproductible et vendable. Ce basculement illustre une évolution plus large : le capitalisme, après avoir produit l’utile au XIXe siècle, produit désormais l’agréable.
L’avènement du capitalisme de consommation
L’après-guerre inaugure un modèle inédit en Occident. En France, cette mutation prend le nom des Trente Glorieuses. La productivité industrielle atteint des sommets, la croissance économique est fulgurante et les foyers s’équipent massivement. L’électroménager, la télévision et l’automobile ne sont plus des luxes mais des biens accessibles. La publicité, omniprésente, modèle les imaginaires, suscite de nouveaux besoins et transforme la vie quotidienne. L’objet utilitaire devient aussi symbole de modernité et de réussite sociale. La carrière de Presley illustre parfaitement ce processus : l’artiste n’est plus seulement reconnu pour sa musique, mais pour tout un univers de produits dérivés – t-shirts, casquettes, pins – qui prolongent son image. La culture cesse d’être purement artistique pour devenir aussi marchandise. Le public ne se contente plus d’écouter, il consomme. L’œuvre devient un prétexte à l’achat, et la consommation un mode d’existence. À travers cette logique, on assiste à la naissance de la culture de masse, où l’art, l’imaginaire et l’identité collective se trouvent absorbés dans la dynamique de marché.
Guy Debord contre le spectacle
Il est évident que ce modèle ne s’est pas imposé en un jour, d’autant plus que celui-ci avait un concurrent : le modèle soviétique marqué par le collectivisme. En France, à partir des années soixante, se constitue une opposition intellectuelle à ce modèle mené par les situationnistes et notamment Guy Debord, qui dans son ouvrage La Société du spectacle paru en 1967, s’affairera à critiquer cette société de consommation déjà bien installé, sous l’angle du spectacle. Le spectacle pour Guy Debord, c’est le stade suprême de l'aliénation, et la forme la plus actuelle de la domination de classe, tout ce qui entoure l’individu doit lui permettre de se consoler de la pauvreté de son existence soumise aux exigences routinières du travail. Pour lui le spectacle englobe des choses aussi variées que les médias en général, mais aussi la guerre, le nationalisme, l'abondance de marchandise et la culture elle-même, tout est fait pour oublier un temps sa propre mortalité. “ Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir”. Toutes ces réflexions créent à partir des années soixante-dix une volonté de sécession au sein d’une frange éduquée des grands centre urbains, c’est le retour à la terre. Ces jeunes réinvestissent dans les campagnes profondes, des fermes et parfois des villages entiers abandonnés lors des exodes ruraux des décennies précédentes. Motivés par une quête de réconciliation avec la nature, de réappropriation de leur quotidien.
Héritages, crises et nouvelles aspirations
Cependant, ces modes de vie alternatifs restent minoritaires et n’ont pas réussi à bouleverser durablement les habitudes collectives. Comment reprocher à un ouvrier des années 1960 d’avoir embrassé le consumérisme, quand celui-ci représentait une amélioration tangible du niveau de vie après des décennies de privations ? Les générations d’après-guerre ont suivi le mouvement de l’histoire, porté par l’euphorie économique. Mais à mesure que les crises se succèdent – chocs pétroliers, crise des subprimes, crise climatique – les limites du capitalisme de consommation apparaissent. La promesse d’un progrès infini ne tient plus. Aujourd’hui, une nouvelle génération, confrontée à la précarité et à un recul du niveau de vie, manifeste une défiance croissante envers ce modèle. Les 18-25 ans aspirent davantage à l’authenticité, au local, au durable, face à un capitalisme qui standardise et uniformise. Ce retour critique n’est pas anodin : il révèle un besoin profond de réinventer le rapport à la consommation et à la culture, et peut-être de renouer avec une forme de création moins dépendante du marché.